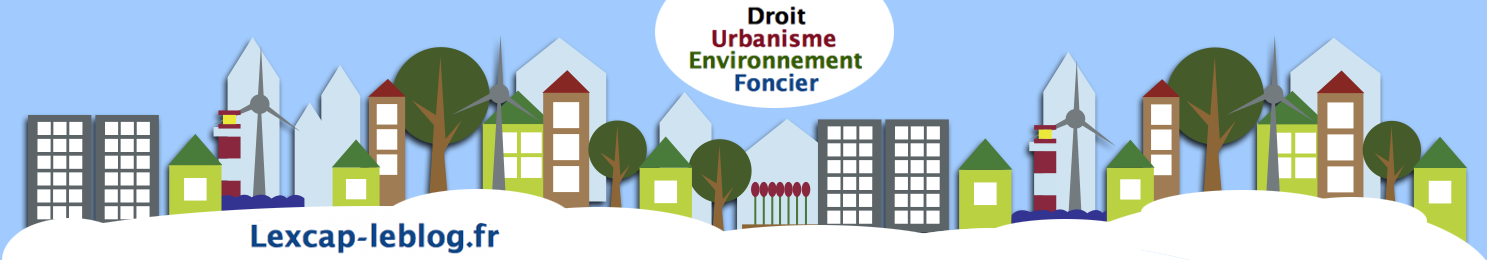Par un arrêt du 13 mars 2019 (n° 419259), le Conseil d’Etat a rappelé les conditions d’exercice du droit de préemption et précisé l’office du juge en la matière.
Une commune avait décidé de préempter une parcelle comportant une maison à usage d’habitation. Les acquéreurs évincés avaient obtenu l’annulation de cette décision devant le tribunal administratif, ce qu’avait confirmé la cour administrative d’appel aux motifs que la commune ne justifiait pas d’un projet à la date de sa décision et que la mise en œuvre de ce droit ne répondait pas à un intérêt général suffisant.
Pour rappel, l’exercice du droit de préemption des collectivités territoriales est encadré par les dispositions de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme et par la jurisprudence qui, sur le fondement de ces dispositions, rappelle de manière constante que « les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en oeuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant » (voir par exemple CE, 8 juin 2016, n° 393612 ; CE, 30 décembre 2014, n° 366149 ; CE, 6 juin 2012, n° 342328).
Saisi par la commune et faisant application de ce principe, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt attaqué considérant que la cour avait commis deux erreurs de droit.
L’arrêt commenté est l’occasion pour la Haute juridiction de rappeler les principes applicables en la matière et de préciser le contrôle opéré par le juge sur les décisions de préemption.
Le Conseil d’Etat rappelle, d’une part, qu’ « il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier la réalité du projet justifiant l’exercice par la commune de son droit de préemption à la date de sa décision et non au moment où elle prend connaissance de la déclaration d’intention d’aliéner le bien considéré. »
Les juges du Palais royal avaient déjà pu formuler à plusieurs reprises ce principe, (CE, 6 juin 2012, n° 342328 ; CE, 3 décembre 2007, n°306949), tout à fait classique dans le contentieux de l’excès de pouvoir, où la légalité d’un acte est appréciée à la date de son édiction.
Fort logiquement donc, le Conseil d’Etat considère qu’ont commis une erreur de droit les juges ayant retenu que le projet justifiant la préemption du bien mis en vente avait été élaboré postérieurement à la réception de la DIA par la commune pour en déduire que la commune ne justifiait pas de la réalité de son projet préalablement à l’exercice du droit de préemption.
Ainsi, peu importe que la commune ait élaboré son projet postérieurement à la réception de la DIA, dès lors qu’elle justifiait de la réalité de ce projet lors de l’édiction de sa décision de préemption.
D’autre part, et c’est là tout l’intérêt de l’arrêt commenté, le Conseil d’Etat précise que « s’il appartient au juge de l’excès de pouvoir de vérifier que la mise en oeuvre du droit de préemption répond à un intérêt général suffisant, la légalité d’une décision de préemption n’est toutefois pas subordonnée à l’exigence que la collectivité ne puisse réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’exercice de ce droit. » Il censure en conséquence l’appréciation de la cour d’appel ayant jugé « que le projet en vue duquel le droit de préemption était exercé ne présentait pas un intérêt général suffisant au motif que la commune n’avait pas justifié de l’impossibilité de le mettre en œuvre sans disposer du bien préempté ».
La solution retenue par la cour d’appel de Versailles n’était guère surprenante, un tel contrôle ayant déjà pu être exercé par des juges du fond en matière de préemption (voir notamment CAA Marseille, 5 mars 2018, n° 16MA01953).
Toutefois, le Conseil d’Etat indique ici clairement que le contrôle opéré par le juge en matière de préemption est distinct de celui opéré en matière d’expropriation. En effet, le juge de l’expropriation vérifie non seulement que l’opération nécessitant l’expropriation répond à une finalité d’intérêt général, mais aussi que l’expropriant n’était pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation (CE, 6 juillet 2016, n°371034 ; CE, 20 novembre 1974, n° 91558).
La limite ici posée au contrôle du juge est surprenante. Rappelons en effet qu’il appartient au juge de contrôler si la préemption répond à un intérêt général suffisant, notamment eu égard au coût prévisible de l’opération. Lors de ce contrôle, il est admis qu’il puisse vérifier que le coût d’acquisition du bien objet de la préemption n’excède pas les capacités financières de la commune (CE, 25 février 2015, n° 371079 ; CAA Lyon, 18 juin 2013, n° 12LY03161).
On peut dès lors regretter que le juge ne puisse aller au bout de cette logique, se cantonnant à contrôler les conditions financières de l’opération d’acquisition, sans toutefois vérifier si la collectivité aurait pu se dispenser d’une telle acquisition.
Ainsi, si la préemption doit répondre à un intérêt général suffisant, il n’appartient pas au juge de vérifier si cette préemption est nécessaire.